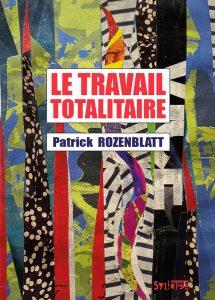 Le travail s’immisce partout, grignotant notre temps libre sous couvert de flexibilité et de modernité. Dans “Le Travail totalitaire” publié aux Editions Syllepse (2025), Patrick Rozenblatt démontre comment, depuis 1968, cette emprise s’est renforcée jusqu’à modeler nos vies entières. Face à cette aliénation, il plaide pour une réappropriation collective du temps, condition essentielle d’une véritable émancipation.
Le travail s’immisce partout, grignotant notre temps libre sous couvert de flexibilité et de modernité. Dans “Le Travail totalitaire” publié aux Editions Syllepse (2025), Patrick Rozenblatt démontre comment, depuis 1968, cette emprise s’est renforcée jusqu’à modeler nos vies entières. Face à cette aliénation, il plaide pour une réappropriation collective du temps, condition essentielle d’une véritable émancipation.
Alain Véronèse nous en livre son analyse…
Le totalitarisme, selon Hannah Arendt est « la négation la plus absolue de la liberté » et la terreur constitue l’essence du totalitarisme. »
Le travail sous l’égide du salariat contrôlé par le capitalisme en version libérale aujourd’hui, peut- il être qualifié de totalitaire ? L’auteur ne donne-t-il dans l’excès pour une critique pourtant fort nécessaire ?
« La condition de l’homme moderne » (une critique, radicale du travail), livre fondamental d’Hannah Arendt est cité p.87.
« Le travail productif ne crée seulement qu’une vie sociale, c’est à dire une vie dans laquelle les hommes, uniformisés, sont asservis à une finalité extérieure à eux et n’existent que comme unités interchangeable d’un ensemble. »
Un totalitarisme souple, invisible (presque).
Les nouvelles technologies, internet, ont permis une « dé-temporalisation » du travail, durant les dimanches et même les vacances, l’ordinateur portable n’est jamais loin qui réclame de l’attention pour le boulot. Ajoutons la « dé-spacialisation », le travail à domicile amplifié durant la crise sanitaire et confinements imposés.
« La tribune titre « La frontière ente temps personnel et temps professionnel s’estompe » et Estelle Leroy décrit comment l’impact des NTIC prolonge le travail jusqu’au domicile. » (cité p. 125).
Plus loin (p.129), Rozenblatt de continuer : « Le « chez-soi » est devenu une unité de production.
[…] D’où une extension de leur temps de travail professionnel avec souvent des reprises d’activités le soir après avoir fini de ranger la maison, voir coucher les enfants . » (p.130).
Le travail omniprésent, « omnistressant » est inséré partout et les loisirs n’échappent guère à la logique productiviste. Il n’est pas incongru de parler d’ emprise totalitaire.
Antique notion à réhabiliter : l’otium
L’auteur plaide pour une réduction massive du temps de travail et (pour notre plus grand plaisir) fait appelle à l’antique (et potentiellement révolutionnaire), à savoir : l’otium. Définition p. 134.
« Pour rappel l’otium latin à une valeur très positive, alors que sa négation le negotium, se rapporte aux affaires et au travail. » J’ai moi même plaidé pour l’otium du peuple, précédé chez les grecs antiques pas les endettés d’aujourd’hui, par la skolé.
Le profit capitaliste procède de la plus-value (ou sur-valeur), qui matériellement parlant est du sur-travail. Il importe de remettre à l’ordre du jour « sur la maîtrise du temps quotidien […] lutte sur le temps et lutte sur le revenu. » (p.85).
Fondamentale cette revendication, car « Les maîtres du temps, sont les maîtres du monde. […] l’enjeu principal : l’appropriation du tempos de la vie humaine. » (p.164).
En commençant par échapper, autant que faire ce peut « au slogan productif : partout à toute heure, avec n’importe quel support ! » (p. 172). Totalitarisme qui s’immisce jusque dans les espaces personnels, voire intime.
L’imagination au pouvoir
La conclusion (p.177), appuie logiquement sur ce qui fut désigné comme essentiel : « Il est urgent de se réapproprier le temps de vivre pour décider ensemble de notre avenir. »
Et « … pour que l’espoir s’étende, que surgisse d’abord une imagination rusée provenant de pratiques résistantes expérimentées au fil du temps. »
L’imagination au pouvoir, mantra des soixante-huitards, ça date un peu, mais la dynamique demeure. « On a raison de se révolter » aujourd’hui plus qu’hier sans doute.
Alain Véronèse.
Mercredi 19 mars 2025.
Mettre l’éditeur du livre : Syllepse.
Oui, il serait possible de réduire le temps de travail en mutualisant le versement d’une partie du salaire de chaque salarié-actionnaire, employé à quart temps pour un salaire temps plein, si leur entreprise est ouverte en permanence. Il s’agirait de favoriser un certain type de workfare ET de capitalisme populaire.
Concrètement, il faudrait attribuer à chaque entreprise une déduction fiscale d’un montant légèrement supérieur (110%?) au salaire minimum légal d’un travailleur à temps plein (1500 EUR/mois?), pour chaque salarié déclaré s’il détient au moins une action représentative de voix, s’il est employé à 10h/semaine au moins, s’il perçoit au moins le salaire mensuel minimum légal d’un travailleur à temps plein, s’il travaille dans une entrperise ouverte 24h/24, 7j/7. En pratiquant le type d’embauche décrite plus haut, l’employeur réaliserait donc une plus value fiscale récompense sa contribution au workfare.
Cet avantage fiscal prendrait la forme d’un titre négociable remis mensuellement à l’entreprise par l’Etat. Deux usages seraient possibles : Soit on l’utilise pour réduire son impôt des sociétés. Soit on l’utilise pour obtenir une réduction (option) sur l’achat d’une action dans une entreprise figurant sur une liste d’entreprises stratégiques désignées par l’Etat. Ce système est pensé pour offrir à entreprises de différentes natures des opportunités de profit variées … sous la condition de contribuer au “workfare” ET au développement du capitalisme populaire.
Quasiment toutes les crises économiques de tous les régimes économiques trouvent leur source dans le fait que les dirigeants n’ont pas agi dans l’intérêt du plus grand nombre, d’où l’importance de la démocratie authentique. Elle peut être définie comme le système politique qui confère la souveraineté au Peuple grâce une bonne éducation, une bonne information et l’exercice de différentes prérogatives politiques, notamment dans le domaine électoral et référendaire. La généralisation du travail à quart temps rémunéré temps plein engendre l’ “otium du peuple”, lui-même favorable à la consommation … et la participation politique. L’effet de cet otium serait plus déterminant dans une démocratie semi-directe incorporant toutes les innovations démocratiques … mais encore moindre que dans une démocratie représentative si l’Etat devenait une stochocratie intégrale, par exemple selon les principes du modèle Campbell Wallace.
Les régimes de travail trop lourds s’opposent à la démocratie authentique sous toutes ses formes : la démocratie politique mais la démocratie économique instituée dans certaines entreprises. N’oublions pas que seul des actionnaires avec droit de vote dans les assemblées générales sont pris en compte dans le système de déduction fiscale présenté plus haut. Donc, une participation politique accrue suppose un certain niveau de “skolè”, de loisir consacré à l’étude. Seulement, il ne suffit pas d’accroître les loisirs pour que les citoyens y consacrent une partie à l’intérêt général. Un incitant, un “misthos” est nécessaire : c’est le dividende social.
Le dividende social serait une allocation de montant variable versée mensuellement et financée par une enveloppe de l’Etat correspondant à la totalité des recettes des amendes perçues par les pouvoirs publics à tous les échelons, au moins une partie des droits de douane et au moins 5% des recettes de l’Etat outre les versements précédents. La caisse de dividende social diviserait ses recettes annuelles en seize mensualités, une étant redistribuée chaque mois, une mensualité supplémentaire étant versée en fin mai et fin novembre. Chaque mois, la somme redistribuée serait divisé en autant de part qu’un certain nombre de fois le nombre d’administrés. Chaque résidant recevrait une part, chaque citoyen une part supplémentaire, chacun des parts supplémentaires selon ses mérites. Chaque entreprise ouverte en permanence recevrait un nombre de parts de dividende social égal au nombre de parts perçus par ceux de ses salariés s’ils répondent aux conditions précitées.
Et le revenu de base dans tout cela ? Un RDB est inutile si son montant est trop bas et trop couteux si son montant est suffisant pour vivre. En revanche, un RDB maximaliste comme celui proposé par le mouvement éco-sociétal(*) peut servir d’objectif social à atteindre. Si un citoyen reçoit un dividende social inférieur à la somme de son revenu social et revenu d’activité, l’Etat lui remet un titre négociable comparable à celui remis aux entreprises et utilisables des mêmes manières.
(*) http://ecosocietal.org/articles.php?lng=fr&pg=10